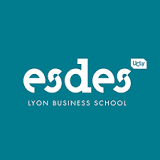Vœux de l’année 2021
Énantiologie de la perspective. Application pour le management.
La perspective désigne une modalité de représentation en trois dimensions d’un objet ou d’une scène, perçue comme un volume dans un plan. Cette représentation exige des calculs rigoureux. Le trompe-l’œil est la modalité qui permet de fournir une imitation imaginaire de la réalité. La perception fait intervenir une opération mentale, dénommée « la suspension volontaire de l’incrédulité » (S. T. Coleridge, 1817), dont l’idée trouve son origine dans l’Ut pictura poesi
d’Horace, et antérieurement dans les œuvres « De gloria Altheniensuim » de Plutarque et La Poétique d’Aristote. Cependant, l’Art lui-même peut-être un trompe-l’œil, car il ne doit traduire que ce qui ne nuit pas à la beauté. Donc, elle peut aussi servir à ignorer. Toutefois, comme dans la sculpture, atteindre la beauté peut comporter de blesser l’objet à sculpter.
Cette opération mentale permet d’exercer ses sentiments et sa créativité, voire d’inventer. Elle permet aussi des mises en situation paradoxales. Elle permet également de percevoir les aspects cachés de la réalité, ainsi que d’exercer sa pensée paradoxale. Cet exercice est à l’origine de grandes découvertes scientifiques, tant en sciences de la nature qu’en sciences humaines. Dans de nombreux cas, les découvertes portent sur l’implicite : l’implicitement vrai (cf. le paradoxe de Hempel, lequel comporte d’ailleurs la perception de l’implicitement contraposé) ou l’implicitement faux (cf. le paradoxe de Russel) qui conduit à restreindre la compréhension d’une situation. Il n’est pas donné qu’une perspective, en logique ou en rationalité soit juste. Il importe de l’examiner en ses conjonctions d’opposés. Ce peut être contrariant évidement si le souhait est de faire valoir un point de vue, y compris s’il est celui de la simplification. Il peut en effet cacher un raisonnement sournois (sophisme).
[l’art poétique]